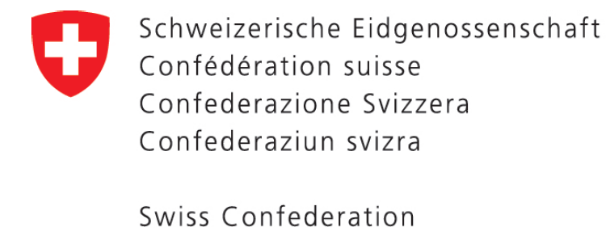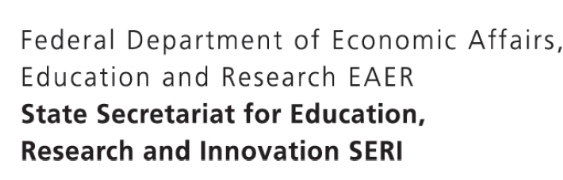S’appuyant sur la recherche clinique et sociale, ce projet a pour objectif d’améliorer la prise en charge des femmes en âge de procréer, exposées au risque de paludisme.
- Pour la première fois au monde, un consortium international prévoit d’entreprendre un essai clinique de phase 3 évaluant des traitements antipaludiques chez des femmes pendant leur premier trimestre de grossesse.
- L’essai évaluera l’efficacité, la sécurité, la tolérance et le rapport coût-efficacité des traitements antipaludiques administrés dans des cas de paludisme simple.
- Cette approche innovante remet en question le statu quo qui exclut généralement les femmes enceintes des essais cliniques. Elle comble une lacune importante en se concentrant sur un groupe souvent négligé : les femmes au premier trimestre de leur grossesse.
Kisumu (Kenya) et Genève (Suisse), 10 juillet 2024. Regroupant des experts dans le domaine de la recherche scientifique et sociale sur le paludisme pendant la grossesse, le consortium Safety of Antimalarials in the FIrst TRimEster (SAFIRE) a aujourd’hui donné le coup d’envoi à la préparation d’un projet qui devrait marquer l’histoire d’une pierre blanche : le tout premier essai clinique de phase 3 testant l’efficacité et la sécurité de traitements antipaludiques administrés aux femmes pendant leur premier trimestre de grossesse.
Bénéficiant du soutien financier de l’entreprise commune EDCTP3 pour la santé mondiale (EDCTP3), partenariat financé par des pays africains et européens, ainsi que par l’Union européenne, et du Secrétariat d’État suisse à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI), le consortium SAFIRE apportera des données sur l’efficacité, la sécurité et la tolérabilité des traitements antipaludiques administrés au cours du premier trimestre de grossesse en menant un essai de type plateforme adaptative et une recherche sociale. Les données générées par ce Consortium seront prises en compte dans les politiques et directives pour que les femmes aient accès à des options de traitement optimales en début de grossesse. Le recrutement des femmes amenées à participer à l’essai débutera en 2025, dans l’attente de données émanant du registre des grossesses de premier trimestre MiMBa et de l’étude PYRAPREG chez les femmes en deuxième et troisième trimestres de grossesses traitées avec des antipaludiques.
Le Dr Hellen Barsosio, qui compte parmi les co-responsables scientifiques du projet et officie en tant qu’assistante de recherche clinique principale en santé maternelle et néonatale auprès de l’Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI – Kenya Medical Research Centre), a déclaré : « Nous sommes enchantés à l’idée de débuter cet essai clinique qui est une grande première. Habituellement, les essais cliniques excluent les femmes enceintes par crainte de nuire à leur santé et à celle de leurs bébés. Le fait d’identifier des traitements antipaludiques efficaces et bien tolérés au cours du premier trimestre de grossesse profitera à toutes les femmes en âge de procréer, y compris à celles qui ignorent qu’elles sont enceintes. En effet, elles pourront suivre ces traitements sans risque pour leur santé ou à celle de leur enfant à venir ».
Malgré les graves risques pour la santé qu’encourent les femmes infectées par le paludisme pendant leur grossesse (fausse couche, bébé mort-né, accouchement prématuré et insuffisance pondérale à la naissance, anémie maternelle sévère, paludisme grave et mortalité maternelle), elles n’ont accès qu’à peu de médicaments pour se soigner (et à aucun pour prévenir l’apparition de la maladie). En premier lieu, l’OMS recommande de traiter le paludisme au moyen de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA). Pour autant, une seule CTA, à savoir l’artéméther-luméfantrine (AL), dont l’utilisation est recommandée depuis 2022, permet de traiter le paludisme simple au cours du premier trimestre de grossesse. Bien qu’il s’agisse d’une avancée essentielle dans le choix équitable d’un traitement contre le paludisme, indépendamment du genre ou d’une éventuelle grossesse, l’émergence d’une résistance aux médicaments dans plusieurs pays d’Afrique est devenue à l’heure actuelle une préoccupation majeure.
L’une des méthodes d’atténuation du risque de voir émerger cette résistance consiste à diversifier les CTA utilisées dans le traitement du paludisme. Malheureusement, cela peut avoir pour conséquence d’exposer par accident des femmes pendant leur premier trimestre de grossesse à des médicaments autres que l’AL. Pour anticiper les risques potentiels, l’essai évaluera pour commencer deux groupes de traitements : l’association pyronaridine-artésunate (PA) et l’AL, largement utilisé, qui servira de point de comparaison.
La PA est une CTA recommandée par l’OMS pour traiter le paludisme auprès de la population générale. À ce jour, les données précliniques et cliniques collectées pour le médicament par les registres de grossesses en cours sont rassurantes concernant les effets sur les mères et leurs bébés.
Des femmes enceintes, non pas protégées de la recherche, mais protégées PAR la recherche
Constitué pour combler le manque de données probantes quant à l’utilisation des médicaments antipaludiques en début de grossesse, le consortium SAFIRE est coordonné par le Centre médical de l’Université d’Amsterdam et codirigé sur le plan scientifique par l’Université des sciences, techniques et technologies de Bamako (USTTB) et par KEMRI. L’essai clinique de phase 3b est coparrainé par Medicines for Malaria Venture (MMV) et la Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM), qui apporteront des contributions techniques et scientifiques au projet. Il s’agira du premier essai de type plateforme adaptative avec analyse statistique bayésienne évaluant l’efficacité, la sécurité et la tolérance des traitements antipaludiques au cours du premier trimestre de grossesse, ce qui constitue un jalon important dans la recherche médicale mondiale. Les données collectées par le consortium SAFIRE, qui commencera dans des sites du Burkina Faso, du Kenya et du Mali, contribueront à la mise au point de futurs essais visant d’autres maladies infectieuses, en particulier celles qui touchent les femmes enceintes dans les pays à revenu faible ou moyen.
Les sciences sociales au service de l’éradication des maladies
Outre la direction scientifique, la recherche sociale et la recherche sur la mise en œuvre joueront un rôle clé dans l’essai : des représentants des institutions participantes mèneront des recherches de formation essentielles dans un premier temps afin de contribuer à la conception finale de l’essai et d’identifier, de recruter et de fidéliser les participants tout au long de l’essai.
Selon Maud Majeres Lugand, directrice associée de la recherche sociale auprès de MMV : « il sera essentiel de nouer le dialogue avec la communauté afin d’instaurer un climat de confiance et de comprendre les éventuels obstacles au recrutement, tels que les sensibilités culturelles et les préoccupations des femmes quant à la prise de médicaments en début de grossesse. L’idée est en effet d’assurer un recrutement éthique et réussi des femmes qui participeront à l’étude clinique ».
Une véritable course contre la montre
Outre la possibilité d’atteindre les objectifs mondiaux en matière de santé et d’égalité des sexes, l’éradication du paludisme présente également des conséquences financières : en effet, cette épidémie représente un fardeau économique et social considérable. Elle s’accompagne de coûts financiers pour les ménages, à la fois directement du fait du coût des soins de santé et indirectement par la perte d’activité économique productive, ce qui nuit à la croissance économique. En identifiant des méthodes plus efficaces pour traiter les maladies et prévenir les décès dus au paludisme maternel, il est donc possible de réduire le fardeau économique qui pèse sur les ménages et d’améliorer l’efficacité des investissements publics dans la lutte contre le paludisme.
Pour autant, la communauté mondiale de la santé a pris du retard par rapport à son objectif d’éradication du paludisme d’ici à 2030, comme le soulignent les programmes de santé, notamment UN Sustainable Development Goals (Objectifs de développement durable des Nations-Unies) et WHO’s Global technical strategy for malaria (Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme de l’OMS). Le professeur Kassoum Kayentao, de l’USTTB, et coresponsable scientifique du consortium SAFIRE, l’affirme : « Il a fallu 20 ans à l’OMS pour recommander de recourir à l’AL pour traiter le paludisme contracté au cours du premier trimestre de grossesse. Il est urgent de proposer d’autres options thérapeutiques administrables au cours de cette phase très épineuse de la grossesse ».
L’objectif ultime du consortium SAFIRE est de donner un coup d’accélérateur aux progrès réalisés en vue de l’éradication du paludisme. Les conclusions de l’étude aideront les professionnels de santé à élaborer des stratégies de lutte et des méthodes de mise en œuvre sur le terrain. « En s’appuyant sur les conclusions de l’essai, il sera possible de proposer une CTA supplémentaire pour traiter le paludisme contracté au cours du premier trimestre de grossesse. L’essai visera aussi à compenser le manque d’équité dans le recrutement des femmes enceintes participant aux essais cliniques », ajoute le professeur Kayentao. Le Dr Michael Makanga, directeur exécutif de l’entreprise commune EDCTP3 pour la santé mondiale, précise : « Pendant la grossesse, le paludisme peut être à l’origine de graves problèmes de santé tant pour la mère que pour son bébé. C’est la raison pour laquelle nous soutenons ce projet crucial, SAFIRE, à hauteur de plus de 5 millions d’euros. De par son approche innovante et inclusive, cet essai de type plateforme adaptative devrait, nous l’espérons, fournir des preuves solides en vue du développement futur d’options de traitement sûres et efficaces pour les femmes enceintes ».